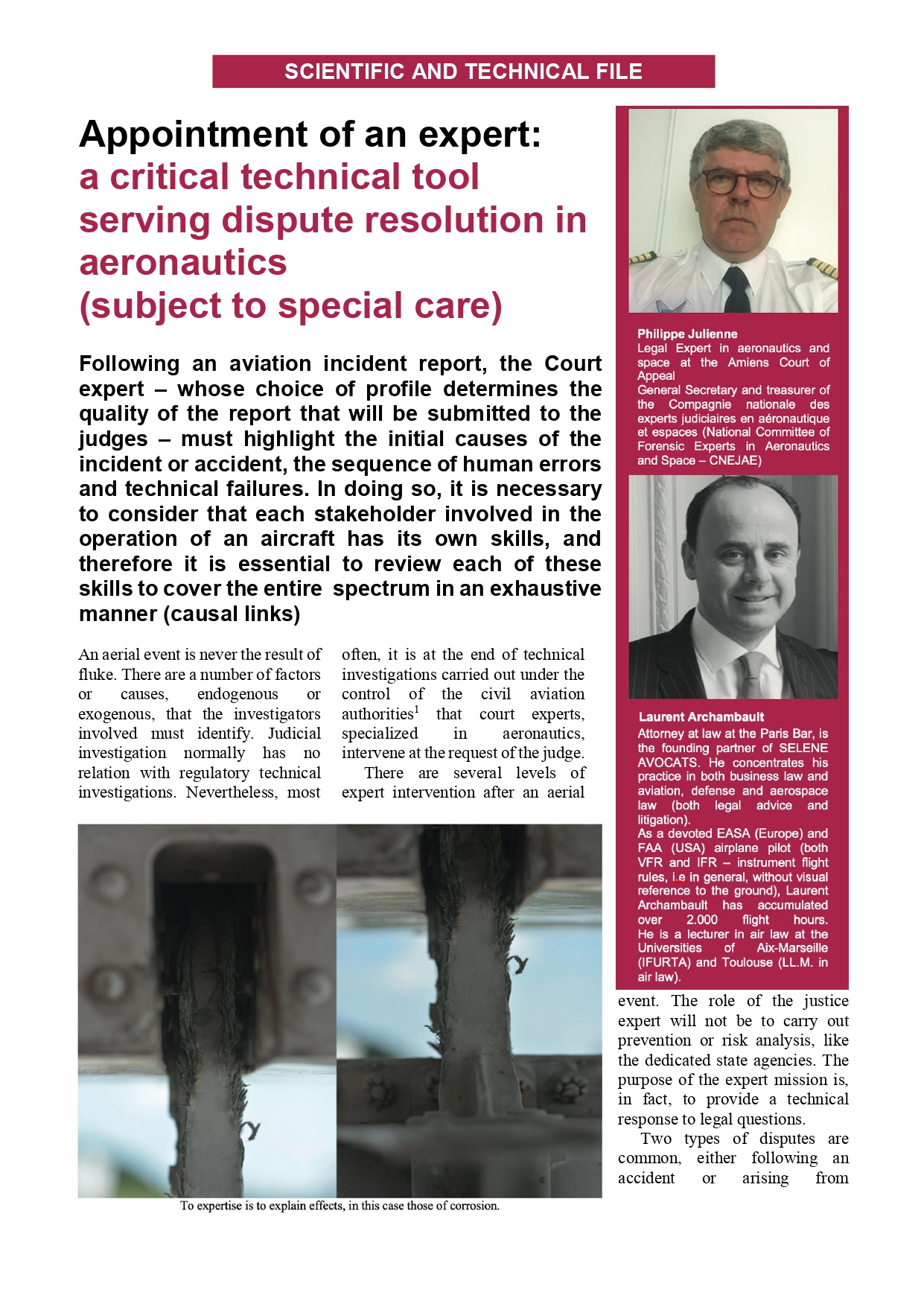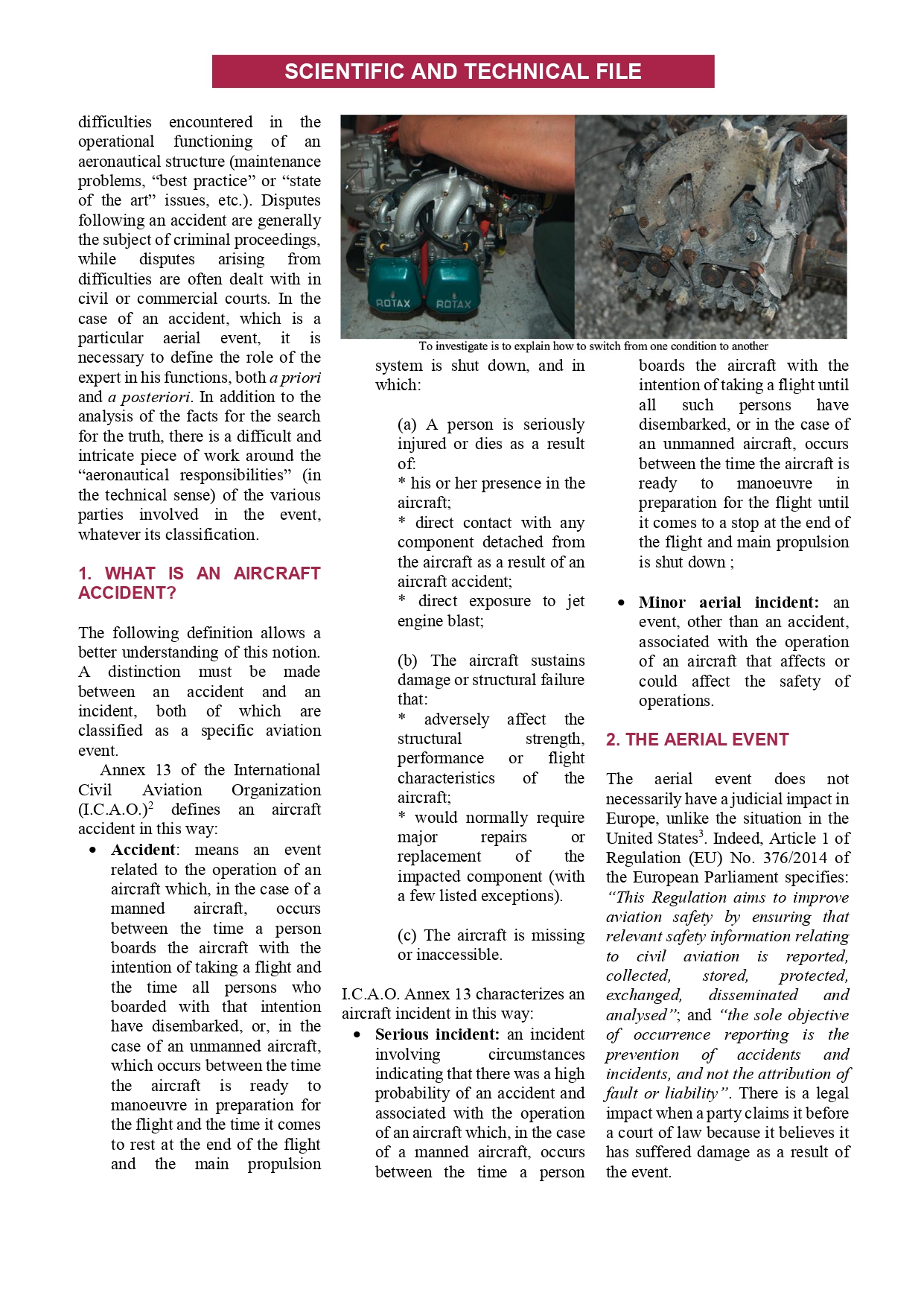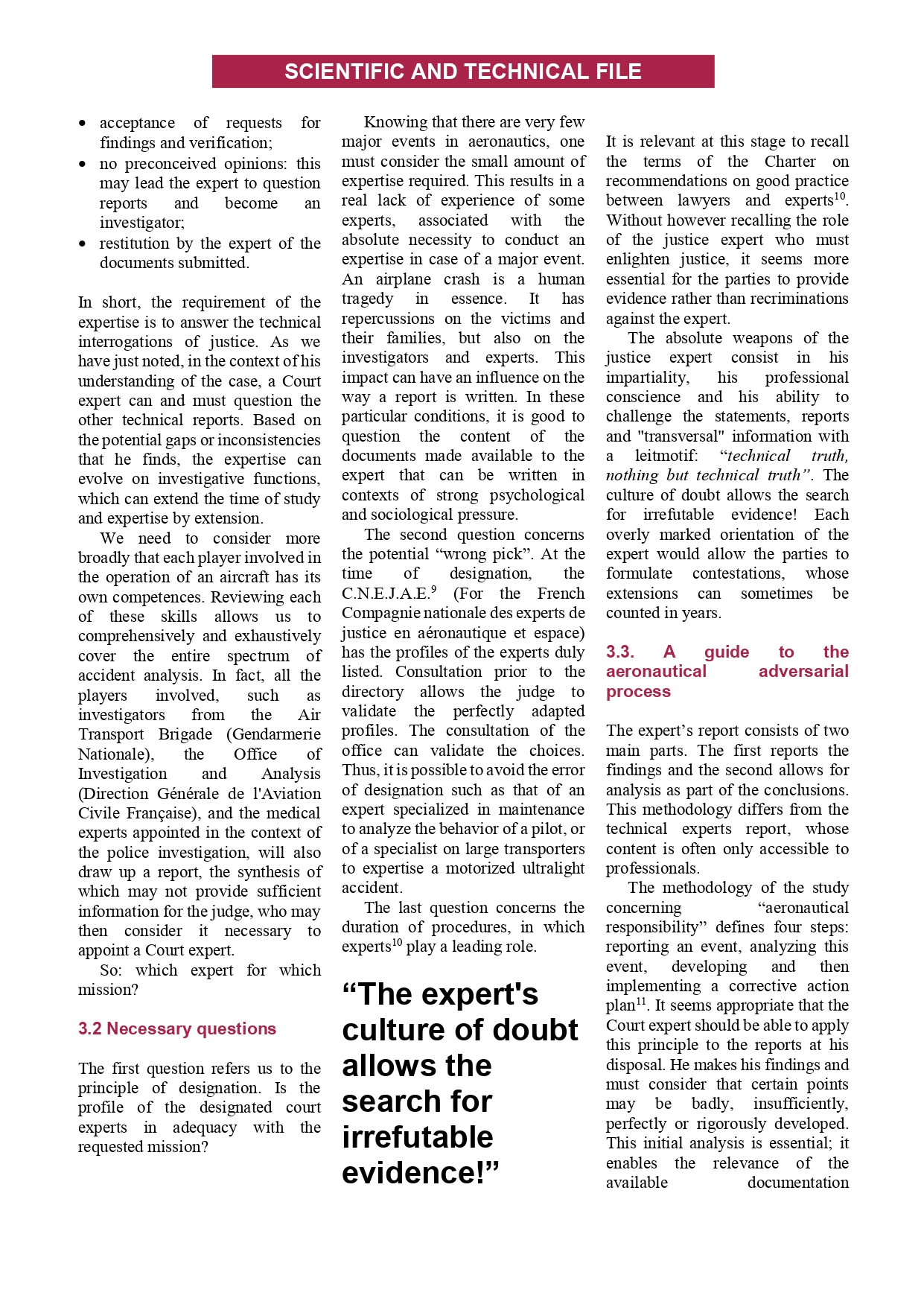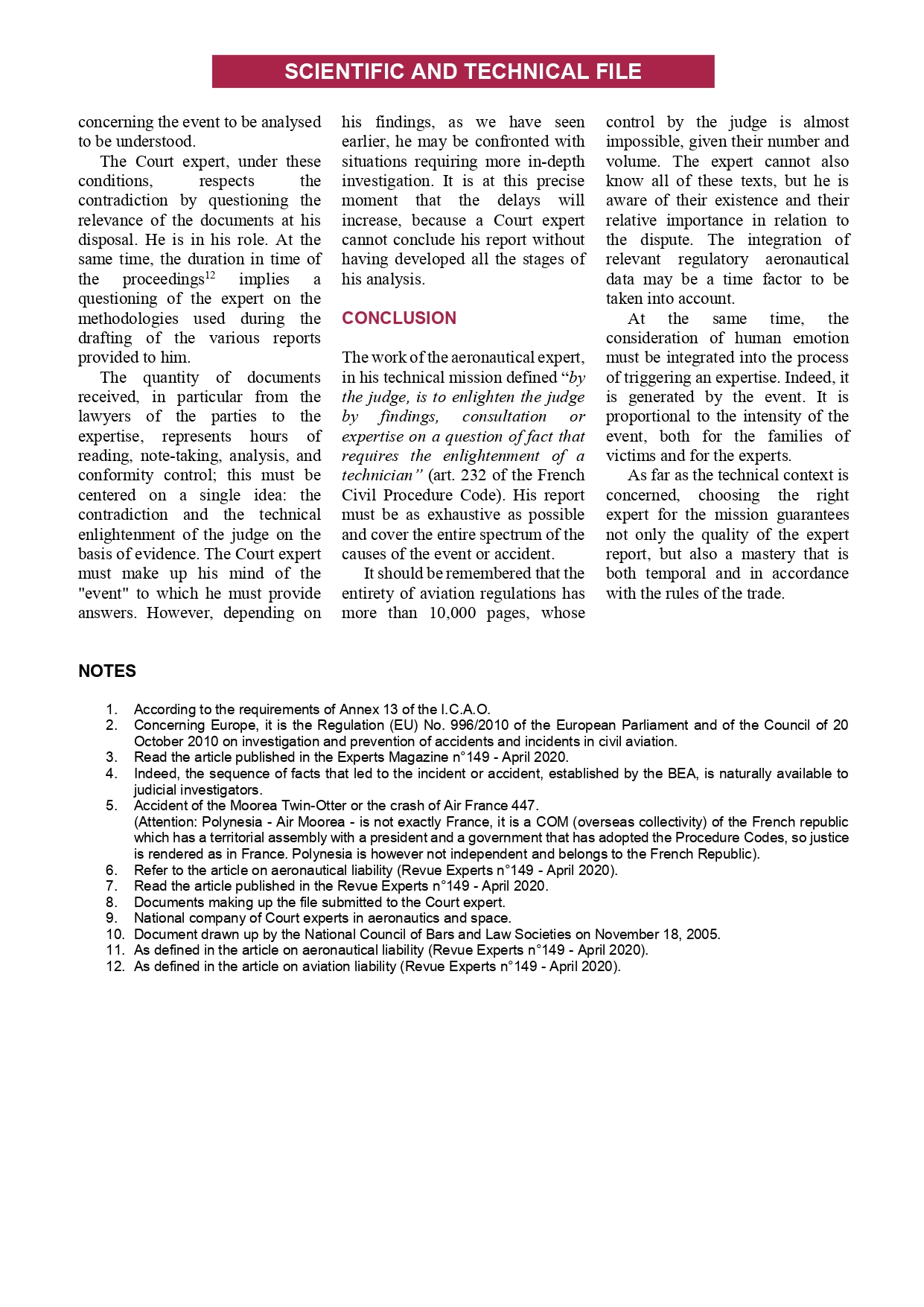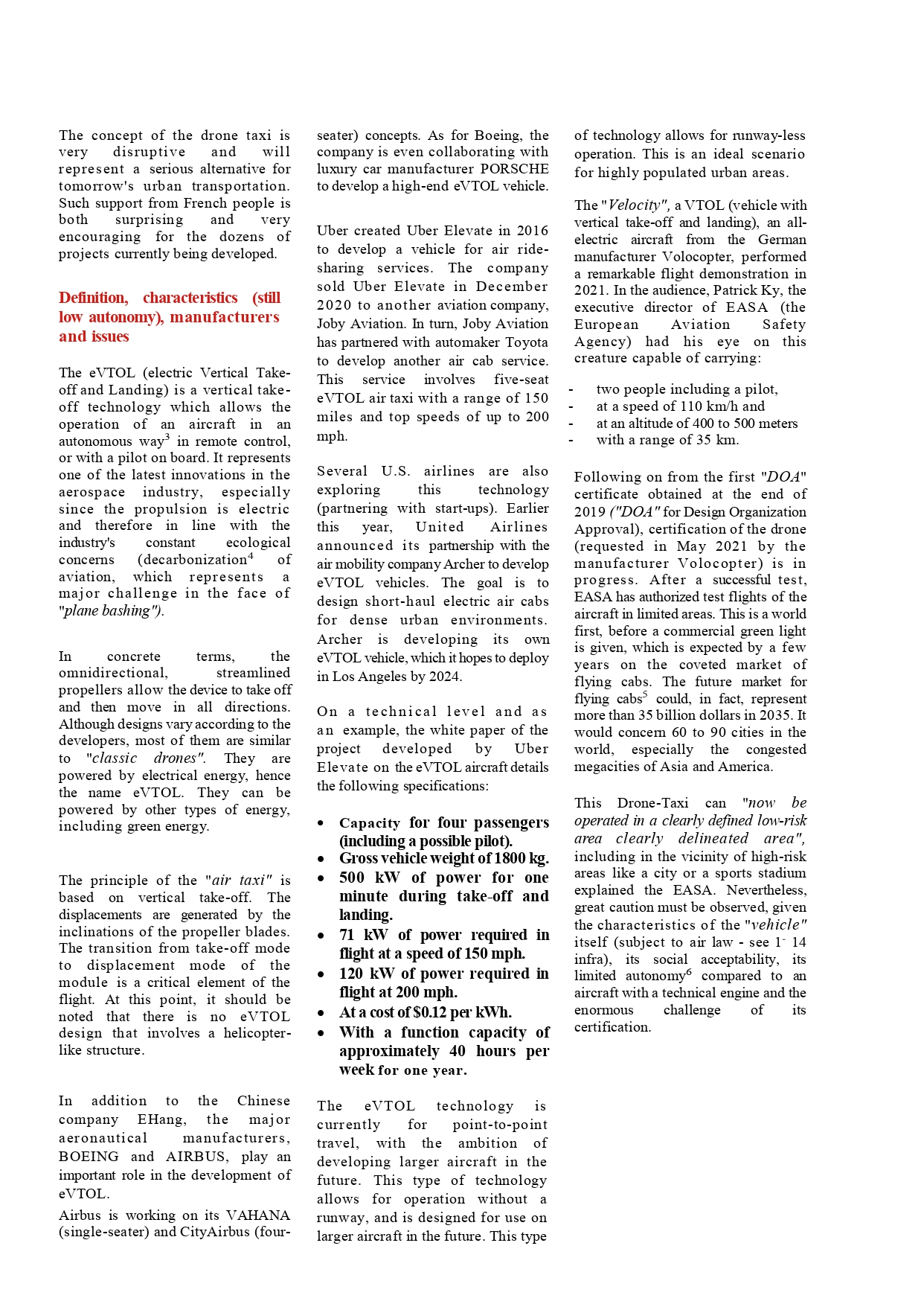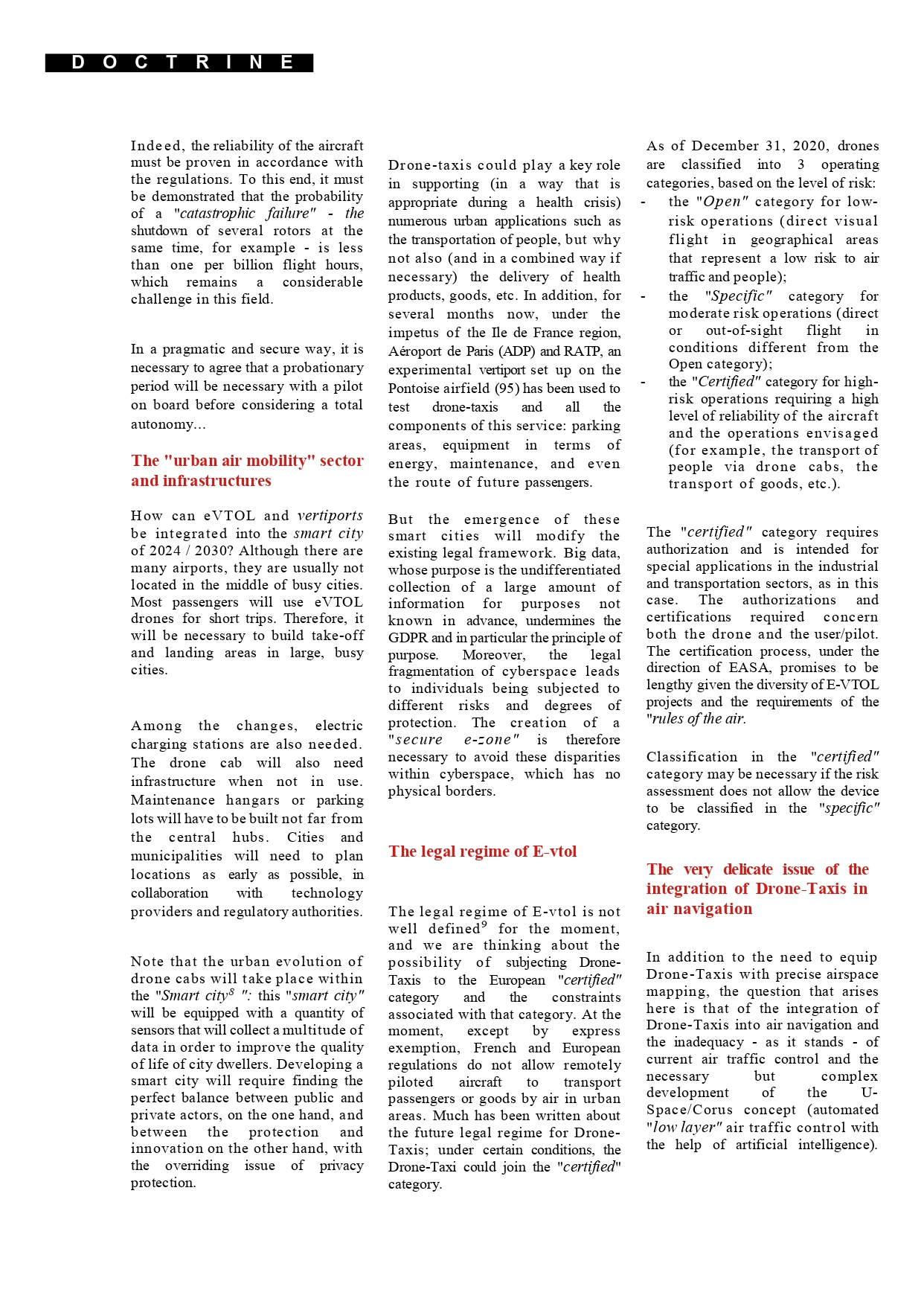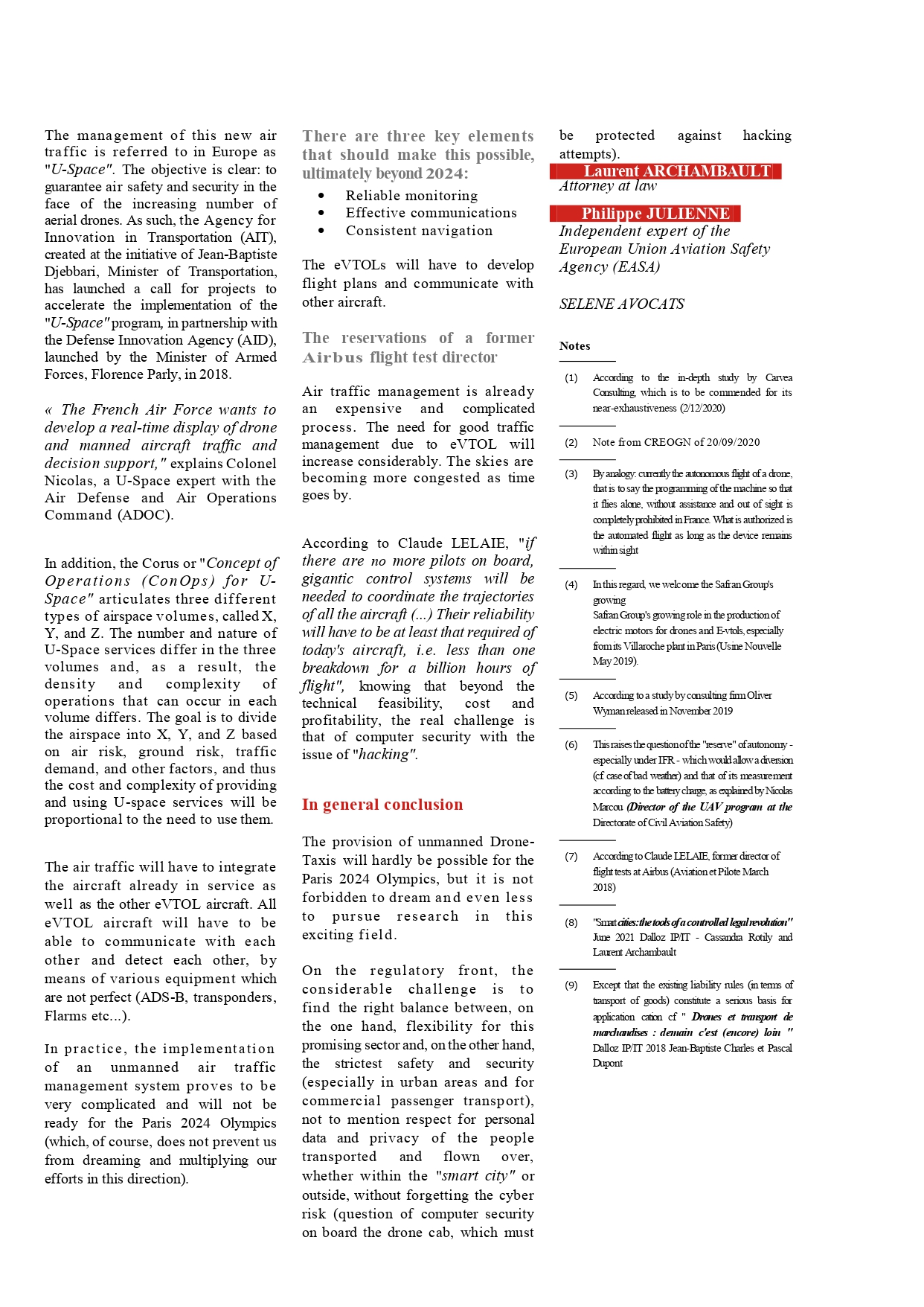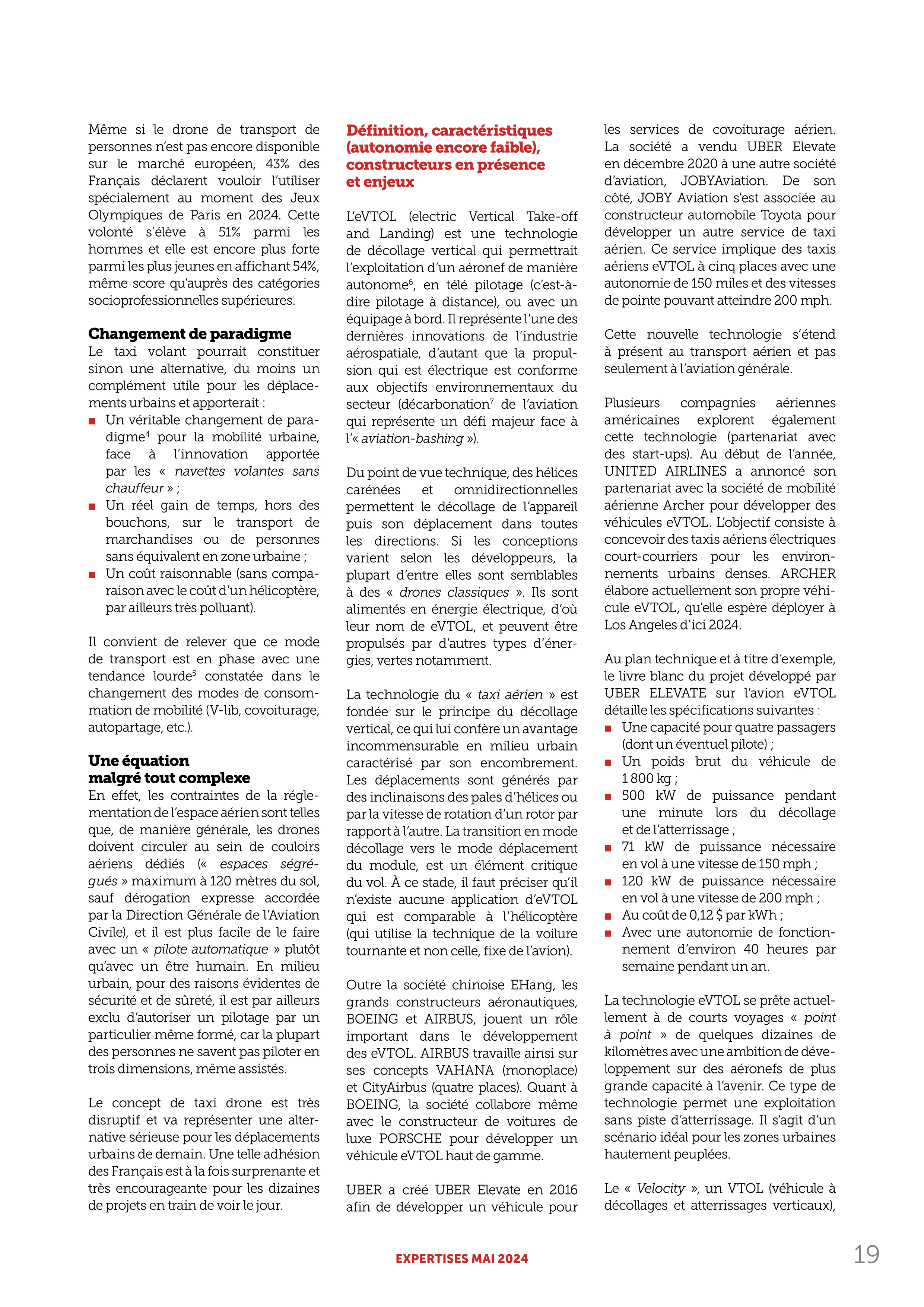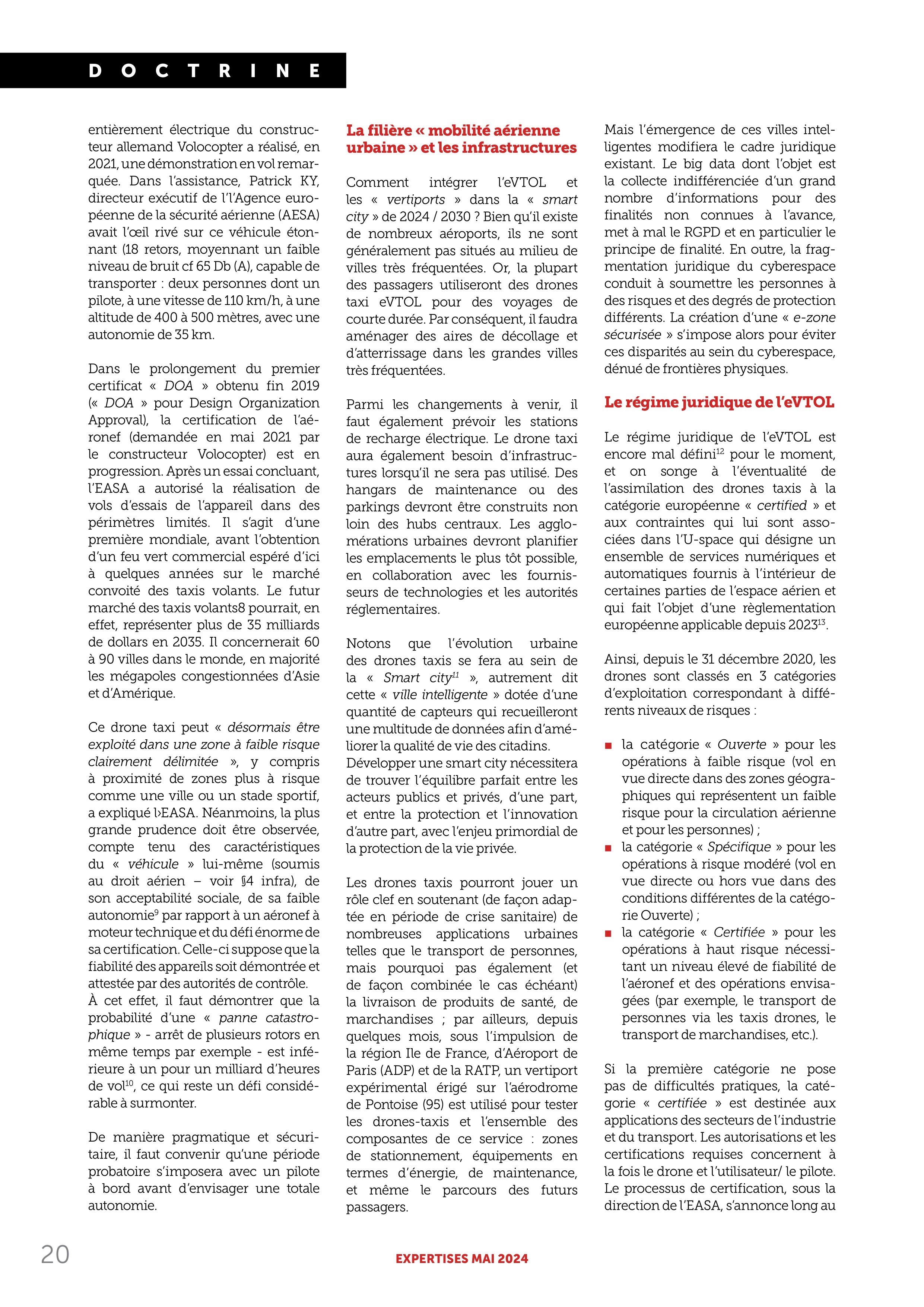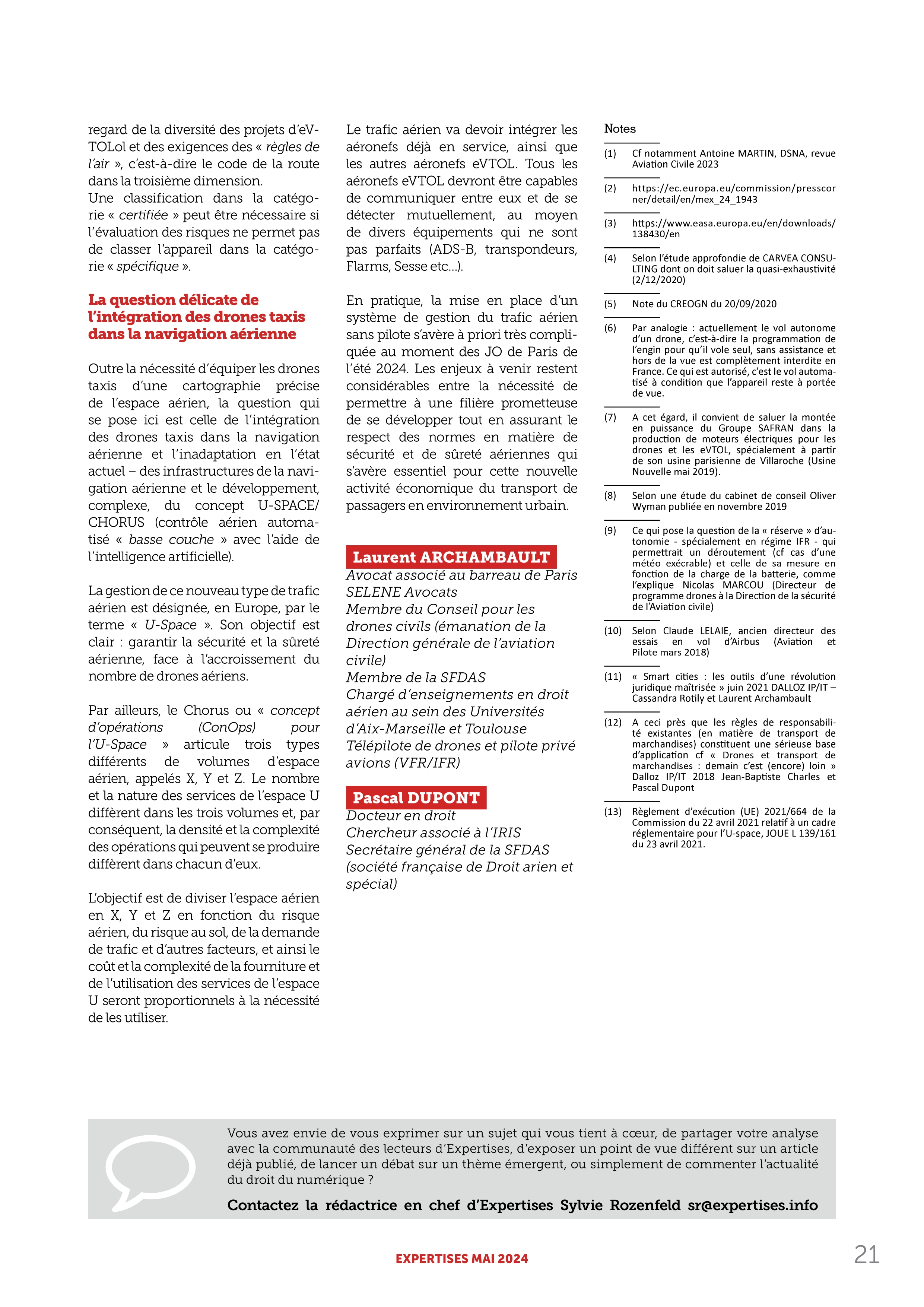Conférence du 19 juin 2023 sur la réforme du droit des contrats spéciaux (Tribunal de commerce de Paris)
SELENE AVOCATS a eu le plaisir d’assister à la conférence sur la réforme du droit des contrats spéciaux, organisée par l’association Droit et Commerce, ce lundi 19 juin 2023 à la Grande salle d’audience du Tribunal de commerce de Paris.
Cette conférence, animée par le président de la Commission chargée de rédiger l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, le Professeur Philippe Stoffel-Munck, a abordé plusieurs points importants.
L’éminent Professeur Stoffel-Munck a rappelé les objectifs de cette réforme, qui étaient de renforcer le droit positif tout en conservant ce qu’il n’était pas utile de supprimer, d’intégrer la jurisprudence dans le droit positif et de moderniser le droit des contrats spéciaux.
A la question de savoir si cette réforme allait aboutir, le Professeur Stoffel-Munck répondait, que s’il n’était pas devin, il était néanmoins très optimiste pour au moins trois raisons.
- D’abord, il existe un consensus sur l’intérêt de cette réforme, en raison des divergences entre le Code et le droit positif. Or une telle divergence est regrettable dans un pays de droit écrit
- Ensuite, il souligne la volonté politique de la part des magistrats de la Chancellerie de réformer le droit des contrats spéciaux
- Enfin, le matériau nécessaire à la faisabilité de cette réforme existe déjà: outre l’offre de loi de l’association Henri Capitant, il y a désormais l’avant-projet de la Commission Stoffel-Munck, comprenant plus de 300 articles. Selon le Professeur, le principe même de l’avant-projet n’a pas été remis en question.
En ce qui concerne le calendrier, le Professeur souligne que la Chancellerie prévoit de préparer un premier projet sur le contrat d’entreprise en 2023, suivi d’un projet sur le contrat de vente en 2024, et les autres projets suivront. Cependant, la date d’adoption de ces projets reste incertaine.
Le président de la Commission a tenu a rappelé l’esprit de l’avant-projet, qui repose sur la codification du droit existant, tout en l’adaptant pour le rendre plus lisible et attractif. Aussi, bien qu’il soit question de réforme des contrats spéciaux, certains contrats, tels que ceux relevant du droit de la famille, la transaction, la fiducie ou encore le contrat de société, ont été expressément exclus de la réforme. Ces « contrats-alliances », contrats par lesquels les parties allient leur force en vue d’une création de richesse, tout comme les contrats « très » spéciaux (par exemple, le contrat d’assurance, le bail d’habitation, etc.) ont été exclus de la réforme.
Seuls les « contrats-échanges » (contrats de vente, de prêt, de dépôt, de séquestre, d’entreprise, de mandat, d’échange ou encore de location), qui impliquent un échange d’utilité, ont été touchés par l’avant-projet de réforme.
Le Professeur a également relevé que le réalisme économique a été pris en compte dans la réforme. Par exemple, l’avant-projet se propose d’introduire dans le Code civil une nouvelle méthode de qualification, qualifiée de « distributive ». Ainsi, dans les contrats complexes chaque pan du contrat sera régi par le régime qui lui est le plus adapté. Le juge devra identifier la prestation caractéristique à l’origine du litige et appliquer le régime adéquat. Ce n’est « qu’en tant que de raison » que cette méthode distributive entrera en jeu. Pour le Professeur, ce standard du « qu’en tant que de raison » qui laisse place à une certaine incertitude, est la rançon nécessaire pour être au plus proche de la réalité économique.
La réforme vise aussi à favoriser la liberté contractuelle. Pour la Commission, il existe suffisamment de dispositifs de protection des contractants introduits depuis 1804 (que ce soit dans le Code de la consommation (« B to C »), dans le Code de commerce (« B to B ») ou dans le Code civil (« C to C »)). C’est pourquoi, s’agissant des contrats spéciaux, la Commission a choisi de favoriser la liberté contractuelle.
Encore, la réforme vise également à simplifier la vie des praticiens en conservant la numérotation habituelle des contrats (ce que le Professeur qualifie de « continuité numérique ») et en préservant le langage du Code civil. Si ce langage peut sembler technique pour un néophyte, le Professeur souligne que tout ne peut être simplifié à l’excès et que le recours à des juristes pour établir des contrats importants est hautement recommandé.
La conférence a également abordé certaines innovations qui font consensus. Par exemple, l’avant-projet se propose de permettre aux contractants de se débarrasser de conventions bancales. Ainsi, une promesse synallagmatique de vente, subordonnée à l’accomplissement d’une formalité ou d’un accord sera caduque après un délai de douze mois. Autre innovation qui fait consensus, celle consistant à limiter les hypothèses où un contrat pourrait subir un anéantissement à cause d’un problème de détermination du prix. Le juge pourra dès lors fixer le prix en se fondant sur les stipulations objectives des parties ou encore nommer un tiers qui fixera le prix.
Cependant, certaines innovations suscitent des débats. Certains textes ont été, selon le Professeur, volontairement inscrits dans l’avant-projet afin de créer un débat. Par exemple, le texte sur la sous-traitance vise à clarifier le régime juridique, en renversant la jurisprudence Besse. Pour le Professeur, il s’agit en réalité de faire réagir le législateur par rapport à la loi sur la sous-traitance, qui a aujourd’hui un champ d’application bien trop large et inadapté.
Un autre sujet de discussion concerne le texte sur le mandat, notamment en ce qui concerne la déclaration de conflit d’intérêt pour le mandataire. Cette déclaration n’a en effet aucune limite de temps, son champ d’application est large et aucune sanction n’est prévue. D’autres textes, comme celui sur la garantie des vices cachés, ont suscité des critiques doctrinales, cette fois-ci involontaires, mais bienvenues.
SELENE AVOCATS remercie le Professeur Stoffel-Munck, ainsi que l’association Droit et Commerce, pour cette riche conférence !
Les carburants durables pour l’aviation : défis, solutions et perspectives
SELENE Avocats a eu le plaisir d’assister à la table ronde organisée par l’IFP Energies nouvelles (IFPEN) ce mardi 23 mai, à l’Apostrophe, Paris, qui portait sur les carburants durables pour l’aviation et les enjeux, les défis ainsi que les perspectives associés.
Les intervenants ont fait ressortir qu’en France, le secteur du transport est responsable de la plus grande partie des émissions de Co2, devant le secteur de l’industrie. Etant donné la croissance continue du secteur aérien, il est important d’agir rapidement en ce qui concerne les carburants durables. Ainsi, les biocarburants, notamment de deuxième génération, sont largement étudiés et considérés comme une solution potentielle.
Les autorités publiques françaises prennent des mesures pour encourager l’utilisation de carburants durables. Ces derniers jouent un rôle essentiel dans la décarbonation, représentent la moitié des efforts nécessaires d’ici 2050.
Sur le plan national, les carburants durables représentent un enjeu majeur pour atteindre l’objectif « zéro carbone » d’ici 2050, fixé dans la feuille de route de la « Stratégie Nationale de Bas-Carbone » (SNBC), introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV du 18/08/2015, révisée en 2018-2019).
Depuis le 1er janvier 2022, la France impose une incorporation d’au moins 1 % de biocarburant dans les carburants utilités pour l’aviation. Il a été constaté que la Commission européenne s’est inspirée de la politique française en la matière, puisqu’elle envisage d’imposer une trajectoire d’incorporation aux producteurs de carburant.
De plus, des intervenants ont souligné que les technologies nécessaires pour développer des carburants durables à l’horizon 2030 existent déjà. Elles comprennent le traitement des huiles végétales, la conversion thermochimique indirecte, la biochimie et les « e-fuel » (carburants de synthèse, produits à partir d’hydrogène et de dioxyde de carbone). Toutes ces technologies doivent être complémentaires. Cependant, pour progresser dans ce domaine il est nécessaire d’avoir des technologies robustes, des sites industriels adaptés, des ressources, un cadre réglementaire et une fiscalité stable ainsi qu’un écosystème solide regroupant tous les acteurs du secteur, et surtout des financements. Or les financements ne sont pas choses aisées : les projets comportent des risques, sont coûteux et le retour sur investissement n’est pas garanti.
Si les objectifs ambitieux fixés par l’Etat français sont à saluer, celui-ci doit aussi, afin d’assurer qu’ils soient atteints, être un acteur actif en investissant massivement dans les nouvelles technologies françaises développées en France.
SELENE Avocats tient à remercier l’ensemble des intervenants pour la qualité de cette table ronde, sur un sujet primordial et d’actualité.
L’aviation décarbonée : enjeu du futur ?
SELENE Avocats a eu le plaisir d’assister au Colloque de grande qualité « L’aviation décarbonée, enjeu du futur ? » organisé par la CNEJAE le 20 octobre 2022 au Centre de conférences Grand Poitiers.
Intervenants :
- David Gallezot – Président des avions Mauboussin
- Laure Singla – Expert spécialisée des questions environnementales
- Alain Battisti – Président de la FNAM et de la compagnie Chalair
Les échanges ont été magnifiquement animés par Philippe Julienne, secrétaire général de la Compagnie Nationale des Experts de Justice en Aéronautique et Espace (CNEJAE) en présence notamment de Mme Françoise Ballet-Blu, députée de Poitiers et M. Philippe Faravel, président du Cercle aéronautique du Parlement.
L’aviation civile est aujourd’hui un acteur social et économique incontournable. Le transport aérien désenclave les territoires, contribue aux échanges internationaux et à la croissance économique. Sa part dans le PIB français s’élève à 4,2% ; l’aviation civile représente 320 000 emplois directs et en 2019, le nombre de passagers d’élevait à 210 millions.
Cependant, le transport aérien contribue également à l’émission des gaz à effets de serre. Si sa part dans les émissions mondiales est relativement faible (2,4%), l’augmentation du trafic prévue et l’urgence de la crise climatique imposent au secteur d’investir massivement dans la recherche et le développement pour réduire cette pollution (et ce, en collaboration – indispensable – avec toutes les parties prenantes au plan européen et mondial).
Le secteur aéronautique a pris des engagements ambitieux, aux niveaux international, européen et national pour réduire ses émissions. De nombreuses initiatives et les premières réussites laissent entrevoir une aviation du futur mettant en œuvre des solutions diversifiées pour atteindre ses objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050.
Tout d’abord, sur le plan technique, les solutions sont pensées en fonction du type de trajet :
- Pour les vols court et moyen courrier, des solutions basées sur des moteurs électriques ou hybrides peuvent être envisagées. Pour la mobilité régionale notamment, des avions légers et silencieux sont déjà construits, notamment par Mauboussin. Un des carburants possibles serait l’hydrogène, à condition notamment d’être en mesure de le produire sans recours aux énergies fossiles.
Dans l’hypothèse d’un recours à l’énergie électrique, les difficultés principales tiennent à l’autonomie encore réduite et aux risques inhérents au fait d’embarquer une batterie à bord qui résiste difficilement aux conditions physiques du vol.
- Pour les vols long courrier, il est, pour l’heure, inenvisageable de se passer de carburant, mais la solution la plus prometteuse pour réduire les émissions est le recours au Sustainable Aviation Fuel (SAF). S’il n’est pas encore disponible en quantité suffisante et à un tarif encore peu raisonnable (au moins 6 fois plus cher que le kérozène), le SAF a fait ses preuves sur le plan technique : dans le cadre de l’une des expérimentations, des avions de ligne ont relié les aéroports de Orly et Toulouse en fonctionnant à 50% au SAF.
Ces évolutions techniques doivent être accompagnées par une réglementation qui, elle aussi, est engagée dans une recherche constante de solutions adaptées. Des voies d’amélioration existent et les avancées techniques créeront indéniablement la confiance nécessaire pour des normes adaptées. A titre d’exemple, on notera les exigences de formation pour les pilotes sur ces nouveaux appareils électriques : elles gagneraient à s’inscrire encore plus en cohérence avec celle pour les avions thermiques, afin de faciliter la transition. Sans aucun doute, les preuves du succès des avions électriques parviendront à convaincre que ces évolutions sont possibles.
Sur le plan réglementaire également, une des voies d’amélioration envisagées serait une clarification des objectifs de réduction des émissions avec l’adoption de règles contraignantes assorties de contrôles effectifs. Des lignes directrices claires aideront les compagnies, les avionneurs et tous les acteurs de l’aviation à orienter leurs efforts de décarbonation.
La tâche du régulateur est particulièrement ardue : si l’aviation est, depuis toujours, un domaine technique, édicter des normes pour en orienter l’évolution demande une compréhension très fine de l’état de la recherche. A cet égard, l’expérience de l’expert de justice apporte un éclairage précieux car il est le seul à même d’apporter une compréhension des enjeux réglementaires en même temps qu’un savoir technique.
Enfin, la réduction des émissions devra nécessairement passer par l’encouragement et l’amélioration des solutions d’intermodalité : une meilleure correspondance entre les transports aériens, ferroviaires et routiers permettra d’optimiser le parcours du passager et lui permettre de choisir le mode de transport optimal.
On retiendra que le secteur aérien dans son ensemble est mobilisé pour développer des solutions. Un changement de mentalités est en cours et l’avenir sera aux solutions multiples : il n’y aura pas de technologie prépondérante qui puisse seule répondre à tous les besoins, mais des phénomènes de compromis permettront de trouver un ensemble de solutions pour parvenir aux objectifs définis. Le changement ne pourra pas non plus se faire sans la confiance des usagers qui devra être obtenue par la démonstration que les avions fonctionnant à l’énergie décarbonée restent un moyen de transport sûr.
Françoise Ballet-Blu, députée de Poitiers a conclu les échanges en réaffirmant son soutien aux initiatives d’innovation. Les avancées déjà réalisées et les efforts de l’industrie rendent optimiste : les progrès déjà réalisés laissent entrevoir une aviation du futur responsable, tant dans son rôle sociétal que dans la maîtrise de ses impacts.
En conclusion un magnifique colloque et merci aux organisateurs !
Et pour finir, une réflexion de SELENE Avocats un tantinet « subversive » ( ?!) : et si l’avenir de l’aviation était conditionné à sa décarbonation, mais également à la réduction du trafic passager et fret à un seuil plus raisonnable ? (prenant notamment en compte le véritable coût du transport aérien et «l’utilité sociale » des déplacements ? ).
Enjeux géopolitiques aéroportuaires : entre guerre des hubs et stratégies de coopération
SELENE Avocats a eu le plaisir d’assister à une conférence organisée par le Comité Aéronautique & Espace des Jeunes IHEDN et Sciences Po Alumni à Sciences-Po le 14 octobre dernier.
SELENE tient à remercier les deux intervenants pour la qualité exceptionnelle de leur intervention :
- Michel Wachenheim, Président de l’Académie de l’Air et de l’espace et ambassadeur français et représentant permanent de la France auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ;
- Edward Arkwright, directeur général exécutif du Groupe ADP.
Les aéroports jouent aujourd’hui un rôle central dans la transformation du secteur de l’aviation civile qui fait face à de nombreux défis (dont l’acuité est particulière dans le contexte de la préparation des JO de Paris 2024).
-
La décarbonation : l’urgence environnementale est aujourd’hui au centre des préoccupations des acteurs de l’aéronautique.
- Si les constructeurs de la chaine de valeur jouent un rôle essentiel dans la recherche et le développement des carburants alternatifs (dont le SAF ou sustainable aviation fuel, carburant alternatif issu de matières premières durables), leur démarche ne peut aboutir sans une concertation et même une véritable coopération internationale avec les aéroports qui doivent être en mesure d’accueillir les infrastructures nécessaires.
- En outre, les aéroports veillent à réduire leur propre empreinte carbone par l’optimisation de leur fonctionnement pour contribuer à l’effort visant à atteindre les objectifs de décarbonation.
-
Augmentation du trafic: la croissance du trafic aérien mondial, quoique ralentie depuis la crise de la Covid-19, reprend en suivant la croissance économique partout dans le monde (traditionnellement et avant le COVID, la croissance du trafic aérien s’élevait à 2 fois le PIB et encore davantage concernant la Turquie, l’Inde et / Chine, étant précisé que le centre de gravité du trafic s’est déplacé vers le Moyen-Orient)
- Ce mouvement d’optimisation commande par ailleurs de repenser les stratégies commerciales des aéroports : il devient nécessaire de limiter le temps passé par chaque passager dans l’aéroport, ce qui constitue un antagonisme avec les intérêts des commerces qui y sont implantés
- L’augmentation des capacités est difficile à envisager car, outre les restrictions imposées par les normes de l’urbanisme, une expansion des aéroports se heurtera nécessairement à l’opposition des riverains. Par conséquent, les aéroports doivent miser sur la diversification des offres de destinations, ce qui remet en question la stratégie des grands hubs.
- Enfin, les aéroports sont confrontés à des exigences particulières de sûreté; tout d’abord, l’augmentation du nombre de passagers impose d’optimiser le fonctionnement des aérogares tout en assurant un niveau de sûreté qui doit rester à la hauteur des menaces toujours présentes (terrorisme notamment) ; par ailleurs, les menaces ont évolué : il s’agit notamment de cybercriminalité, de présence de drones ou encore de passagers indisciplinés, ce qui nécessite un effort constant de veille et de recherche pour maintenir leur résilience.
Ces problématiques touchent l’ensemble du secteur aéronautique et il ne sera possible de réussir les transformations nécessaires que grâce à une coopération entre tous les acteurs, à grande échelle. Ainsi, on assiste à l’émergence de grands groupes aéroportuaires, à l’image de « Aéroports de Paris ». Loin de se limiter à la capitale française, ce groupe est présent dans plus de 130 aéroports partout dans le monde et il convient de saluer son essor.
Cette expansion favorise l’efficacité dans la gestion des risques les plus diversifiés. Outre les moyens de recherche et de développement mis en œuvre pour assurer la sécurité et la sûreté en amont, les équipes des groupes aéroportuaires affinent en permanence leur savoir-faire dans la gestion de crises sanitaires, politiques ou sécuritaires pour ensuite en faire bénéficier l’ensemble du groupe et pouvoir ainsi réagir rapidement.
La coopération pour la transformation du transport aérien n’est pas limitée aux acteurs aéronautiques. En effet, la gestion de la croissance du nombre des passagers dans les conditions de capacités limitées impose d’encourager et de développer des solutions d’intermodalité des transports, ce qui est mis en œuvre en collaboration avec les transporteurs ferroviaires et routiers.
Enfin, la transformation du secteur aérien serait impossible sans le soutien des pouvoirs publics qui ont pour rôle d’encourager la concurrence et stimuler l’émergence de nouvelles façons de fonctionner.
La mobilisation des aéroports aux côtés de tous les acteurs impliqués contribue à une transformation globale pour répondre à ces défis de taille. L’aviation civile continue d’assurer son rôle d’accélérateur de croissance et de coopération internationale tout en préparant un avenir qu’on espère plus durable et toujours aussi sûr, particulièrement en prévision des JO de Paris en 2024.
LE TRANSPORT URBAIN DE PASSAGERS PAR AÉRONEFS ELECTRIQUES (Urban Transportation of Passengers by eVTOL)
SELENE Avocats a eu le plaisir d’assister à un colloque de haute tenue organisée par L’ACADEMIE DE L’AIR ET DE L’ESPACE dans les locaux de la DGAC à Paris les 21 et 22 septembre derniers.
La thématique était « Urban transportation of passengers by eVTOL »
Deux jours de débats passionnants avec les meilleurs experts du monde entier, incluant ceux de l’ONERA, du MIT et de la NASA
Dans un avenir plus ou moins proche, les taxis et VTC V-lib et autres formules telles que le covoiturage, autopartage etc…auront peut-être un sérieux concurrent : le taxi-drone ou e-VTOL pour « electric vertical and take off landing »
Autrement dit, un taxi volant (avec chauffeur initialement) pressenti pour permettre, en théorie, aux participants aux JO de Paris 2024, de rejoindre le centre de Paris en 15 minutes à partir des aéroports d’Orly ou Roissy, en survolant les embouteillages traditionnels de la région parisienne.
L’eVTOL, c’est la voiture du futur (2030/2035 a priori), c’est un véhicule en 3D, et ce n’est pas de la science-fiction, car le taxi volant autonome sera une réalité. Mais nous sommes ici en présence d’un changement de paradigme : il ne faut plus penser en termes d’aviation traditionnelle !
La course entre les constructeurs est lancée : pas moins de huit projets de taxi-drone ont de grandes chances d’aboutir à l’avenir. Airbus se place également sur ce créneau et Volocopter continue de faire la course en tête en Europe.
Mais le chemin pour le rendre utilisable techniquement, juridiquement et surtout économiquement, est encore assez long au vu des nombreux défis et parmi ceux-ci :
- Défi de l’acceptabilité sociale par les personnes survolées et les riverains des « vertiports » (futurs sites de décollage de d’atterrissage des VTOL)
- Exigences réglementaires intrinsèques: navigabilité du VTOL (conception, fabrication, entretien), règles opérationnelles à respecter (trajectoires publiées etc), autonomie et fiabilité des batteries (question qualifications des pilotes puis des télépilotes
- Intégration dans la circulation aérienne à basse altitude (cohabitation avec les hélicoptères et les trafics commerciaux au décollage ou en approche sur les aéroports voisins)
- Nécessité de se conformer aux exigences réglementaires extrinsèques et juridiquesen matière de sûreté, cybersécurité, cadre sonore (limitation des décibels) et vie privée/données personnelles
- Intégration du VTOL dans la future smart city (ville connectée devant accueillir notamment les futures voitures autonomes et eVTOL)
Les défis sont de taille mais la dynamique créée par les principaux acteurs (dont AIRBUS, EHANG et VOLOCOPTER) est très vertueuse et la coopération domestique, européenne et internationale sans faille !
IA et justice
Les répercussions de l’usage de l’intelligence artificielle sur les pratiques juridiques, un équilibre constant entre bienfaits et limites.
L’intelligence artificielle est « l’une des évolutions majeures de ces dernières années dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, et elle devrait continuer à se développer dans les années à venir. Il convient de mieux discerner ses incidences dans le domaine de la justice en ligne ».
Retrouvez notre dernier article paru dans le n°481 de juillet 2022 de la revue Expertises, rédigé par Maître Laurent Archambault, Avocat à la Cour et Maureen Noone, stagiaire en contentieux des affaires. 



Servir la France : 10 ans du portail de l’IE (Intelligence Economique), 15ème édition du Gala de l’IE et 25 ans de l’EGE (Ecole de Guerre Économique) : félicitations et remerciements aux organisateurs
Le 30 juin 2022, le cabinet SÉLÈNE Avocats (représenté par Louise Maréchal, stagiaire, réserviste et membre des Jeunes IHEDN) a eu le plaisir d’assister au colloque organisé par l’Association de l’Ecole de Guerre économique (AEGE) et le Portail de l’IE en coopération avec Assas Junior Entreprise et EGE Junior Entreprise.
Il réunissait 11 experts autour du thème « Servir la France ». Ce colloque de qualité a été l’occasion d’assister à cinq tables rondes allant de la réindustrialisation à la guerre de demain, en passant par l’armement, les investissements et intérêts français et le numérique.
Pour un cabinet d’avocats (dont le gérant a servi au sein du 6eme bataillon de chasseurs alpins de Grenoble et qui n’est pas insensible à la sphère militaire en particulier les drones militaires), ce fut l’occasion de se remettre en question, de réactualiser ses connaissances et de :
- prendre conscience davantage d’un certain nombre de phénomènes plus ou moins inquiétants (fait que la guerre de demain soit passée à 5 dimensions : Terre, Mer, Air, mais aussi Espace et Cyber ! Et « guerre du numérique » générant le cas échéant des questions de droit ;
- voir « plus loin et plus large » : en effet, un dossier juridique ou judiciaire en particulier à l’international, comporte de multiples facettes – dont la dimension géopolitique – qu’il convient en permanence d’intégrer en vue d’une compréhension complète des enjeux d’un dossier).
Avant d’aborder ces différents enjeux, le directeur de l’EGE, Monsieur Christian Harbulot a prononcé quelques mots particulièrement intéressants.
Tout d’abord, il a présenté l’EGE, fondée en 1997, et sa formation dont la vocation est de s’inscrire dans le temps en servant la France. Aujourd’hui, l’EGE dénombre 3000 anciens dont la plupart ont travaillé dans les renseignements. Il existe donc un lien étroit entre l’EGE et l’armée française.
Il y a une réelle volonté de créer une culture écrite de la « guerre de l’information ». Pour cela, il est important de transmettre et d’interpréter la connaissance, y compris celle de l’ennemi, c’est fondamental. Reste à savoir qui est « l’ennemi »…
Actuellement, la population française n’est pas prête à intégrer pleinement les « paramètres » notre monde. Celui-ci se divise en trois :
- le premier est celui de la mondialisation, il n’est plus possible de comparer l’économie chinoise avec l’économie américaine, ce sont des systèmes économiques différents. On constate ainsi que l’enseignement supérieur français enseigne un monde du passé. Il faut pourtant s’adapter et repenser les rapports de force ;
- le deuxième monde est celui qui est apparu avec la pandémie autrement dit celui de la dépendance économiquequi a de lourdes conséquences. En effet, les besoins vitaux ne concernent plus l’appareil d’état, or la doctrine concerne cet appareil d’état, mais elle ne va pas au-delà. Les lois du marché ne répondent pas à ses besoins vitaux. Là encore, cela n’est pas enseigné ;
- le troisième monde correspond aux comportements économiques et de créativité sociale générés par la relocalisation. On observe par exemple un système absurde de paiement des énergies en France avec un problème notamment sur l’appréhension du nucléaire sur lequel les avis divergent grandement.
Finalement, on remarque l’importance de la rhétorique et de l’enseignement. Comment faire comprendre aux jeunes que le futur ne consiste pas seulement à trouver une belle profession, mais également à se souvenir de son pays et de « ce qu’on lui doit » ? Ainsi, ces tables rondes avaient vocation à répondre à ces interrogations et expliquer comment servir la France en ces temps agités et complexes.
Afin de ne pas abuser de la patience des lecteurs, les auteurs de cette brève chez SÉLÈNE Avocats, se contenteront dans un premier temps de lister ci-dessous les thèmes des 5 tables rondes et en profiteront pour remercier les divers intervenants pour la qualité de leurs interventions, mais également Maryanne NABET (diplômée de l’EGE et récemment brillamment admise au barreau de Paris) pour son aimable invitation.
Table ronde n°1 : Réinventer l’État stratège – Réindustrialiser la France
Intervenants :
- Anaïs Voy-Gillis, Docteure en géographie de l’Institut français de Géopolitique et spécialiste des questions industrielles
- Yves-Marie Cann, Managing director de FGS Global et ancien conseiller auprès de la ministre déléguée chargée de l’industrie
- Cécile Dekeuwer, Présidente de WeCo et avocate de formation, membre du collectif start-up industrielles France
Table ronde n°2 : Droit et compétitivité : le cas de l’export d’armement
Intervenant :
- Philippe Graver, consultant senior chez Wagram Consulting, ancien chef du bureau Asie du Sud à la DGA et ancien responsable contrôle export chez NAVAL GROUP
Table ronde n°3 : Protéger les investissements et intérêts français en Afrique
Intervenants :
- David Hornus, fondateur de CORPGUARD (conseil en IE et Risk management), auteur de « Danger zone. Témoignage d’un professionnel de la gestion de crise »
- Nicolas Boutinot, Directeur adjoint Business Unit de ARISE « Amarante Risk Intelligence & Strategic Expertise »
- Peer De Jong, Vice-Président de Themiis
Table ronde n°4 : Comment la France lutte-t-elle contre les ingérences numériques étrangères ?
Intervenant :
- Gabriel Ferriol, chef de service de VIGINUM
Table ronde n°5 : Les guerres de demain
Intervenants :
- Vice Amiral d’escadre Arnaud Coustillière, Premier officier général à la cyberdéfense et créateur de la DIGINUM
- Capitaine Pierre Doutre, officier de l’OTAN et spécialiste des PSY-OPS
- Arnaud Walter, ingénieur en chef de l’armement à la DGA, service S2IE (service des affaires industrielles et de l’intelligence économique)